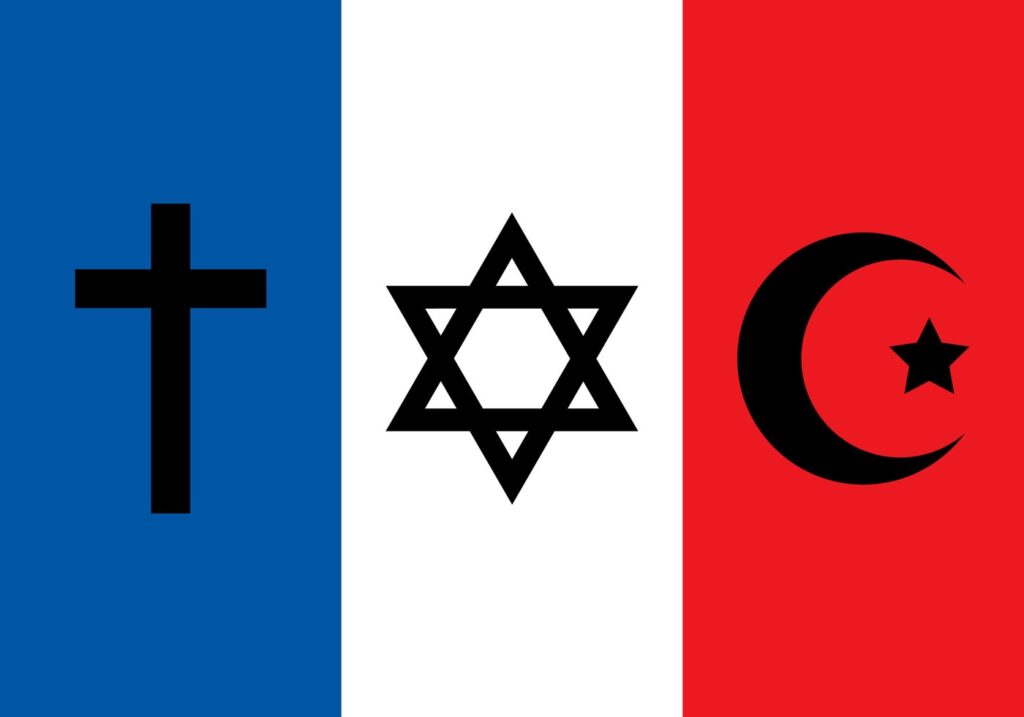Les fins dernières sont traditionnellement identifiées à la mort, au Jugement, à l’Enfer et au Paradis – on y adjoint le Purgatoire, même s’il s’agit par définition d’une réalité avant-dernière et transitoire. Et il est bien vrai que ces quatre fins, qui disent la destinée ultime et définitive de l’homme, nous apparaissent singulièrement problématiques.
La mort risque de n’être plus perçue dans un sens homogène à la Bible. La croyance en la réincarnation se diffuse dans les contrées anciennement chrétiennes. Les souffrances physiques et morales précédant la mort font peur et semblent porter atteinte à la dignité de l’homme. Dans les cas les plus extrêmes, l’idée d’euthanasie pourrait bien substituer à la mort comme fin dernière une décision ultime de l’homme refusant sa déchéance.
L’idée de Jugement risque elle aussi d’être connotée très négativement. Non seulement notre rapport collectif à la loi et à la norme morale se transforme mais les chrétiens eux-mêmes pourraient bien contribuer à cette relativisation du jugement, en invoquant comme argument la parole de Jésus lui-même : « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés » (Matthieu 7,1). Cette parole ne s’applique-t-elle pas à l’Église, qui devrait renoncer à toute forme de jugement moral ? Ne s’applique-t-elle pas à Dieu lui-même ?
En dépendance étroite du Jugement, la simple idée de l’Enfer et d’un Dieu condamnant pour toujours le pécheur est odieuse à beaucoup. Selon l’expression percutante d’un théologien contemporain, « l’homme est meilleur qu’un Dieu qui permettrait l’Enfer ». Quant aux représentations habituelles de l’Enfer – orchestrant le feu, un puits sans fond, des diables armés de piques –, elles suscitent parfois des sourires moqueurs, parfois des remarques érudites, mais semblent de moins en moins posséder une vérité existentielle intrinsèque.
Le Paradis paraît plus facilement toléré, au moins par ceux qui professent croire en l’Évangile. Mais la Résurrection des corps, qui lui est liée, est peut-être moins facile à accepter que jamais, tant il est vrai que nous sommes de plus en plus tentés de voir la matière comme un pur matériau disponible à notre agir technique, sans aucun rapport avec notre vie spirituelle . Comme pour l’Enfer, bien des représentations traditionnelles du Paradis nous semblent dépourvues de force, de capacité évocatrice et mobilisatrice.
Le Purgatoire, enfin, a presque totalement disparu de la conscience catholique, non sans lien avec l’incompréhension dont souffre parfois le sacrement de Réconciliation, ce qui n’est guère surprenant si l’on songe que pénitence sacramentelle et pénitence du Purgatoire sont liées l’une à l’autre.
Ces difficultés clairement énoncées, il n’en demeure pas moins que délester le christianisme des fins dernières reviendrait à le dénaturer et à le transformer en une autre réalité, à en faire une religion n’ayant plus grand rapport avec l’Écriture et la Tradition.
Considérons la mort dont saint Paul nous dit qu’elle est le signe irrécusable de l’amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous » (Romains 5,8). Comment éprouver la vérité de cette affirmation centrale du kérygme si la mort ne signifie plus rien de définitif à nos yeux ? Si, au lieu de symboliser la passion propre à toute existence humaine, le lieu où la liberté se découvre déprise de tout pouvoir d’action et où seul le consentement amoureux à la volonté de Dieu a encore un sens, elle se transforme en occasion prométhéenne de dominer la finitude – par l’euthanasie ou l’immortalité dont le trans-humanisme nous assure qu’elle est pour demain ?
Regardons maintenant le Jugement de Dieu, quand bien même nous voudrions l’évacuer de notre horizon de pensée. Avons-nous un moyen plus efficace de montrer que le dernier mot de notre vie, celui qui scellera pour l’éternité son sens et sa vérité, ne sera pas prononcé par nous-même mais par un autre ? Un tel renversement – le propre du jugement est d’être hors des prises de l’accusé – n’est-il pas consubstantiel à la foi comme abandon dans les mains de Dieu ? « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour », disait saint Jean de la Croix. Effacez le jugement, il n’est pas certain que l’amour et la foi subsistent bien longtemps dans le cœur des chrétiens.
L’Enfer, ce qui est infernus, « en-dessous », faisait peur à nos ancêtres. Aujourd’hui, l’Enfer fait sourire et l’on dit en clignant de l’œil que l’on aurait beau creuser profond, on ne trouverait rien de semblable au lieu de perdition évoqué par la doctrine chrétienne. Mais ceux qui pensent s’être émancipés de cette image renvoient-ils vraiment les consciences au sérieux et à la gravité des actes humains ? Il est vrai que le pardon divin nous est toujours offert et qu’il est sans limite. Sommes-nous si certains de l’accueillir au soir de notre vie, quelle qu’ait été par ailleurs la texture de nos choix grands ou petits ? Faire le mal fait mal, d’abord à l’âme du pécheur. Le péché endurcit son cœur et le rend de plus en plus imperméable à l’offre du pardon. C’est bien cette sclérose progressive qui risque de s’éterniser en Enfer, la colère de Dieu n’ayant de son côté d’autre contenu que l’amour maintenu pour celui qui, définitivement, a dit non. Paradoxalement il faut croire à l’Enfer non pas malgré l’amour de Dieu pour les pécheurs mais au nom de cet amour. Supprimez l’Enfer, l’amour divin pâlit et se transforme en vague bienveillance pour une humanité certes perfectible mais finalement bien excusable dans ses égarements : on s’éloigne alors de la gravité de l’amour divin révélé par la Bible.
Le Paradis pose une difficulté particulière. L’étymologie est bien connue, « paradis » venant d’un mot persan signifiant « enclos » puis « jardin ». Le Paradis est le jardin où nous jouirons de l’intimité de Dieu, il est ce qui nous est promis si nous demeurons fidèles à l’Évangile. Nous savons que nous y serons plongés, corps et âme, dans une éternité de joie, d’amour et de vérité. Mais Jésus lui-même reste extrêmement discret sur la nature exacte de cette béatitude. Une promesse nous est faite, nous l’accueillons avec foi, et plus que pour tout le reste la foi implique ici obscurité pour l’intelligence. Avec le Paradis, il s’agit moins de regarder en face des réalités effrayantes – la mort, le Jugement, l’Enfer – que de gager sa vie sur l’invisible. Cela était difficile pour nos pères dans la foi, cela le demeure pour nous, tant il est vrai que notre manière habituelle de connaître et d’agir passe par le corps et les sens. Si nous oublions le Paradis, nous ne perdons pas grand-chose en termes de représentation du Salut mais nous perdons l’attrait pour l’invisible en tant que tel. La foi n’y survivrait pas longtemps, si du moins la définition qu’en donne l’Épître aux Hébreux contient quelque vérité : « La foi est la garantie des biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas. » (11,1)
Les fins dernières sont intérieurement reliées à la foi et à la charité, nous venons de le voir. L’Épître aux Hébreux invite à ressaisir ces Fins du point de vue de l’espérance et c’est à vrai dire la vertu théologale qui leur est la plus directement appropriée. Une chose est de croire que le Christ a sauvé le monde par la Croix. Autre chose d’espérer que, dans ce Salut, je m’y retrouve. Ce que la foi énonce en troisième personne, l’espérance le négocie en première personne, en « Je ». De part et d’autres il y a des obstacles mais ce ne sont pas les mêmes : lenteur de notre intelligence à comprendre les Saintes Écritures et le dessein de Dieu pour la foi (voir Luc 24,25) ; péchés que je commets en dépit de ma foi et qui sont autant d’obstacles pour que le Salut, auquel je crois pourtant, me soit effectivement communiqué. Si la foi donne de contempler le Salut comme un Bien, l’espérance l’appréhende, en langage thomiste, comme un Bien difficile.
Ainsi le propre de l’espérance est de déloger le sujet croyant de toute posture de domination face aux réalités du Salut. Je puis croire en Dieu et vivre comme si, en réalité, mon existence ne dépendait que de moi-même. Une telle foi est compatible avec l’espoir ou l’optimisme. Elle ne l’est pas avec l’espérance. Je ne puis espérer sans m’appuyer sur Dieu, dans la mesure où le Bien que j’espère m’est inaccessible par sa nature même. Et ce caractère inaccessible, à un moment ou à un autre, doit s’imposer à moi dans une certaine souffrance ou un climat de crise. C’est quand il n’y a plus d’espoir que l’espérance peut se lever.
L’espérance met donc en contact avec Dieu, plus directement ou en tout cas plus existentiellement que la vertu de foi. S’appuyer sur Dieu, c’est aussi reconnaître que toutes les fins dernières – y compris l’Enfer ! – communiquent selon un mode propre l’amour de Dieu pour sa créature, c’est-à-dire Dieu lui-même.
Reprenant les fins dernières dans la perspective de l’espérance, on comprend mieux quel risque fait courir leur oubli dans la prédication et la vie chrétiennes : celui de réduire le christianisme à un humanisme idéologique ou un messianisme politique qui, tout en gardant un vocabulaire traditionnel, le videraient de tout contenu spirituel parce qu’il n’y aurait plus nécessité de s’appuyer sur Dieu pour atteindre Dieu.
Article paru dans Communio 2018/6 (N° 260), pages 7 à 16.